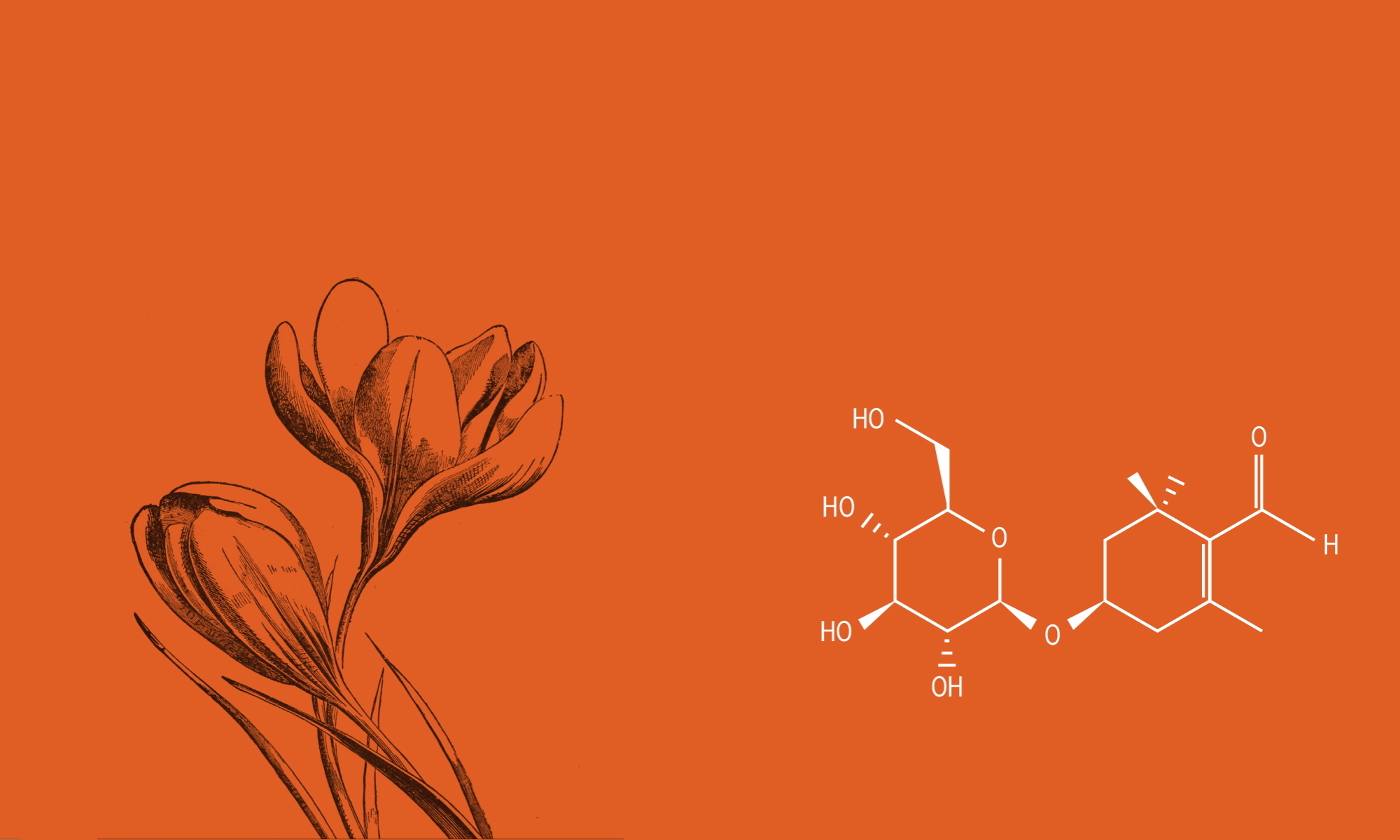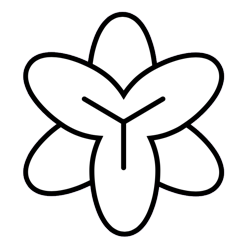Marie-Christine Bureau, Antonella Corsani
Dans Revue Française de Socio-Économie 2015/1 (n° 15), pages 213 à 231
1 – Introduction
Au milieu des années 1990, un nouveau concept naît dans le champ de l’insertion par l’économique : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE). Ces coopératives émanent de travailleuses sociales militantes qui ont développé une réflexion critique, tant à l’égard des pratiques instituées de leur profession que des injonctions politiques à la création d’entreprise, et qui recherchent des solutions innovantes en puisant aux sources du socialisme autogestionnaire. Dans une période de déploiement des initiatives de l’économie solidaire, les CAE revendiquent leur statut coopératif, s’enracinant ainsi dans la tradition beaucoup plus ancienne de l’économie sociale [1]. Par rapport à la forme traditionnelle de la coopérative, les CAE présentent l’originalité d’être des coopératives pluriactives d’entrepreneurs. Elles visent à concilier « l’autonomie de l’entrepreneuriat individuel avec la dynamique et la protection collective du salariat » [Demoustier, 2006, p. 129]. Les CAE offrent aux porteurs de projet les avantages du statut social de salarié tout en leur permettant de travailler à leur compte pour développer leur activité. Si la coopérative fonctionne à la fois comme une société de portage salarial et comme une pépinière d’entreprises, elle est irréductible à l’une et à l’autre, du fait de la non-sélection des projets retenus, du caractère permanent de l’accompagnement (individuel et collectif) et surtout du fait qu’elle vise non pas la création de multiples entreprises individuelles mais le développement d’une entreprise partagée d’entrepreneurs-salariés. Plusieurs CAE sont actuellement engagées dans un processus de réflexion et de transformation d’elles-mêmes, afin d’aller plus loin dans la consolidation d’une « indépendance à plusieurs ». L’objet de cet article est de donner à voir ce qui s’élabore au cours de ce processus et que nous proposons d’analyser en termes de fabrique institutionnelle. À cette fin, nous préciserons d’abord la spécificité de notre démarche de recherche et ce que nous entendons par cette expression de « fabrique institutionnelle ». Puis nous mettrons en scène l’histoire des CAE, les circonstances de leur naissance, les racines qui les nourrissent, la tension permanente qui traverse le développement de leur projet. Enfin, nous nous centrerons sur une CAE francilienne, Coopaname [2] et nous montrerons quelques-unes de ses dynamiques d’évolution. Nous en interrogerons la portée et les limites pour imaginer de nouvelles institutions, au-delà de la logique binaire à l’intérieur de laquelle a été enfermé le travail.
2 – Une enquête dans les rouages de la fabrique institutionnelle
À ce jour, les CAE ont fait l’objet de publications de la part de leurs promoteurs [Bost, 2011 ; Poncin, 2004] mais elles n’ont guère retenu l’attention des chercheurs. Les travaux de Sandrine Stervinou et Christine Noël ainsi que ceux de Fanny Darbus constituent à cet égard une exception. Alors que S. Stervinou et C. Noël mettent en exergue, dans une revue de management, le rôle que peuvent jouer les CAE dans le développement d’une économie locale et d’un entrepreneuriat responsable [Stervinou, Noël, 2008], l’analyse de F. Darbus s’attache à montrer que les CAE abritent en fait une forme dégradée du salariat [Darbus, 2006]. À l’issue d’une série d’entretiens menés auprès d’entrepreneurs-salariés, l’auteure voit dans ce type de coopérative le cheval de Troie d’une forme d’emploi inédite, le salariat libéral : « Sous couvert d’expérimentation » [Darbus, 2006, p. 23], la CAE agirait principalement comme espace de reconversion pour des salariés disqualifiés sur le marché de l’emploi en leur offrant un cadre juridique pour exercer leur activité. Mais elle ne ferait que prolonger ainsi « des formes de précarité objective » [Darbus, 2006, p. 33]. Les quelques données disponibles sur le temps de travail mensuel déclaré et sur les revenus des entrepreneurs-salariés corroborent, aujourd’hui encore, le constat fait par F. Darbus de la précarité financière vécue par un grand nombre d’entre eux. Néanmoins, son analyse, polarisée par la référence à la norme d’emploi fordiste, passe entièrement sous silence l’épaisseur de l’organisation, ses dynamiques d’évolution et la créativité qui s’y déploie. Or le sens des expérimentations menées au sein des CAE est aussi la production de droits nouveaux au sein de la « zone grise » entre travail indépendant et travail salarié. Notre approche prend donc le contrepied de la posture adoptée par F. Darbus : au lieu de centrer notre analyse sur les trajectoires individuelles, nous nous efforçons de montrer comment à l’intérieur d’une CAE s’élaborent de nouvelles formes de relations professionnelles et de liens entre activité individuelle et engagement collectif, en nous attachant au sens que cette création institutionnelle revêt pour les membres de la coopérative et aux perspectives qu’elle dessine pour le futur.
Nous parlons de fabrique institutionnelle pour désigner ce travail de longue haleine, accompli par les acteurs engagés dans le processus pour faire évoluer les catégories, imaginer des alternatives et les faire reconnaître à différents niveaux de légitimité : chartes, accords partenariaux, droit du travail et de la protection sociale, etc. Ce travail participe de l’auto-institution permanente de la société, au sens où l’entend Cornélius Castoriadis. Si l’on admet avec l’auteur que l’institution est un réseau symbolique où se combinent une composante fonctionnelle et une composante imaginaire [Castoriadis, 1975], la fabrique institutionnelle suppose à la fois de mettre en œuvre un imaginaire et des moyens d’action. C’est autant un travail sur le langage et la pensée qu’un combat pour faire exister de nouveaux droits [3].
Notre recherche ne se situe pas dans une position d’extériorité par rapport à ce processus puisque l’enquête participe de la fabrique institutionnelle. Le cadre institutionnel de la recherche est en effet double. La recherche s’inscrit à la fois dans un projet ANR et dans une recherche-action au sein de Coopaname. Le projet ANR porte sur L’évolution des normes d’emploi et nouvelles formes d’inégalités : vers une comparaison des zones grises ? Il s’agit d’une recherche comparative, de nature essentiellement théorique, et qui questionne les zones grises du travail, en particulier entre travail salarié et travail indépendant. Les CAE en constituent un cas particulièrement intéressant, la preuve empirique que si les zones grises sont des « zones hors droits sociaux », des zones de précarité, elles sont aussi des zones d’expérimentation sociale et d’invention institutionnelle. Lorsque nous nous sommes intéressées à ce genre nouveau d’entreprise coopérative, nous avons été très vite amenées à rencontrer des membres de Coopaname. Nous avons été par la suite sollicitées par la commission Recherche de cette CAE pour suivre et alimenter les réflexions autour de son projet de devenir une « mutuelle de travail ». Nous avons alors été invitées à participer à des moments de la vie de la coopérative et à en observer les modes de fonctionnement. Progressivement nous sommes parvenues, en accord avec les membres de la coopérative, à envisager de mener une enquête.
La conception de l’enquête est marquée par les apports de John Dewey. Pour Dewey, l’enquête constitue l’effort qui est mis pour résoudre un problème, ici, dans le cas de Coopaname, la précarité financière de bon nombre de ses membres qui fragilise les parcours individuels et collectifs. L’enquête, toujours selon Dewey, n’est pas un outil de connaissance sur la réalité finalisée à elle-même, mais une action qui vise une transformation de la réalité : elle n’est pas neutre mais joue un rôle actif dans le changement. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer ex ante une date de fin de l’enquête ; celle-ci s’inscrit dans les temps longs de la transformation. La validation des résultats, en tant que propositions de solution des problèmes, ne tient qu’à la validité des solutions des problèmes qui ont suscité l’enquête. Une telle conception nous conduit à adopter une approche séquentielle : des résultats sont atteints à chaque phase de l’enquête et ils constituent le point de départ des phases successives. Dans cet article, nous présentons les résultats d’une première phase de l’enquête.
Pour mener l’enquête, nous nous appuyons sur un ensemble de documents (internes aux CAE mais aussi publics comme les publications par les acteurs des CAE) et avons mis en place différents dispositifs au fur et à mesure que notre objet commençait à se configurer. Nous avons organisé deux ateliers (ou entretiens collectifs), l’un avec des nouveaux arrivants à Coopaname, l’autre avec des membres anciens. Ces ateliers constituent un dispositif d’enquête très riche par les échanges qu’ils permettent entre les participants. Nous avons mené aussi une dizaine d’entretiens individuels semi-directifs, orientés par les questions qui se posent dans les différentes étapes de l’enquête et à partir aussi des événements nouveaux. Nous participons comme observateurs à des moments de la vie de la coopérative et suivons régulièrement les échanges de messages sur l’extranet. Tous ces matériaux sont travaillés de manière séquentielle. Au fur et à mesure que nous parvenons à quelques résultats, nous soumettons ces résultats au débat avec les membres de la coopérative et envisageons les nouvelles étapes. L’analyse qualitative n’exclut pas l’analyse quantitative. Une phase d’enquête par questionnaire portant sur les temps et sur les revenus est en cours. Mais plus qu’un simple outil permettant de collecter des informations systématiques, le questionnaire constitue l’aboutissement d’un processus deconnaissance car son élaboration par une communauté de chercheurs (scientifiques et non scientifiques) exige une analyse réflexive sur les pratiques et sur les questions qui comptent. Il s’agit aussi de mieux définir les problèmes tels qu’ils sont vécus et ressentis subjectivement. Finalement, l’objectivation réside dans le processus qui permet de déplacer le problème initial. L’histoire des CAE est en quelque sorte l’histoire du déplacement des problèmes par des pratiques démocratiques de recherche de solutions.
3 – De la critique du travail social à l’innovation institutionnelle
La naissance des CAE est indissociable de la crise de l’emploi et de la critique des politiques de l’emploi. Parmi ses acteurs, certains ont une expérience militante au sein des milieux de l’éducation populaire, mais aussi comme travailleurs sociaux impliqués dans les politiques d’insertion, d’accompagnement au retour à l’emploi ou à la création d’entreprises. Et c’est à partir d’une critique du travail social que se configurent progressivement le projet des CAE et leur évolution.
3.1 – Les travailleurs sociaux et la critique du travail social
Depuis la fin des années 1970, le chômage de masse, la discontinuité des relations d’emploi et la précarité des emplois s’imposent progressivement comme nouvelles conditions du marché du travail. Déjà à cette époque, des travailleurs sociaux s’interrogent sur le sens de leur action « car ils ne cautionnent pas les mesures palliatives de l’insertion sociale » [Poncin, 2002, p. 66]. Certains d’entre eux vont alors élaborer avec des artisans, des ouvriers et des artistes, des projets associatifs et coopératifs, en dehors des institutions chargées de mettre en œuvre les politiques sociales. Parmi ces projets figure la SARL-SMTS (Société de Manutention de Travaux et Services) à Grenoble, devenue SCOP en 1995, une expérience sur laquelle nous reviendrons par la suite dans la mesure où elle va inspirer la création de la première CAE.
Au fur et à mesure que la crise de l’emploi devient structurelle et que la philosophie qui inspire les politiques de l’emploi évolue d’une logique d’insertion vers une logique d’accompagnement vers l’emploi et la création d’entreprises, la critique menée par les travailleurs sociaux s’étend et se transforme. L’histoire du Revenu minimum d’insertion (RMI) est éclairante à cet égard. Annoncé comme une mesure provisoire, le RMI est rapidement devenu au cours des années 1990, du fait de l’explosion du nombre des ayants droit, un pilier fondamental du système de protection sociale (branche famille) relevant de la logique de la solidarité (financée par l’impôt). Au moment de sa création, le RMI était octroyé sans contrepartie, il constituait un droit – un droit au revenu mais aussi à l’insertion –, bien plus qu’une obligation d’insertion. Le contrat d’insertion visait l’engagement de la collectivité envers elle-même plutôt que la responsabilisation des allocataires. C’est pourtant ce deuxième sens que le contrat a progressivement revêtu depuis vingt ans [Duvoux, 2012], en cohérence avec la philosophie qui a pris le pas dans la conception des politiques de l’emploi, selon laquelle il ne s’agit pas tant d’intervenir sur le comportement des offreurs que sur celui des demandeurs d’emploi. La logique de l’insertion est abandonnée, au profit de dispositifs d’accompagnement [Fretel, 2013], l’objectif visé étant de faire des personnes privées d’emploi des demandeurs actifs, adaptables aux conditions du marché du travail [Divay, 2012]. Certains travailleurs sociaux dénoncent alors ces dispositifs comme étant « la courroie de transmission d’une thérapeutique sociale “par l’emploi”. […] Pour le dire vite, le travail social institutionnel devient un travail sur la crise du lien avec l’économie, un mode de restauration du “capital humain” de chacun dans les mondes du travail précaire, dont les travailleurs sociaux sont les petites mains de plus en plus anachroniques » [Rafanel i Orra, 2011, p. 142-146]. Le travailleur social se voit sommé de devenir un manager « de la précarité de masse » : « Peu de travailleurs sociaux aiment se sentir des kapos de l’entreprise marchande, des pourvoyeurs d’une main-d’œuvre docile, prête à travailler pour des salaires de misère dans les secteurs dits “en tension”. » [Rafanel i Orra, 2011, p. 148] Les objectifs de motivation, de reprise en main de soi, d’autonomie et de responsabilité traduisent la « mise en politique de la subjectivité » [Cantelli, Genard, 2007], tandis que les accompagnants sont eux-mêmes soumis aux contrôles des pratiques et des comportements [Divay, 2012].
Cette mise en politique de la subjectivité culmine avec la promotion de la figure de l’entrepreneur, dans un projet global de transformation de chaque individu en entrepreneur de soi. Déjà à la fin des années 1970, Raymond Barre avait proposé aux chômeurs de créer leur emploi, mais c’est avec la loi Madelin de 1995 que s’opère un véritable tournant, avec la multiplication des dispositifs d’incitation à la création d’entreprises. La création du statut d’auto-entrepreneur en constitue l’aboutissement. « Cessons de créer des entreprises », écrit alors Stéphane Veyer [2010] directeur général de Coopaname, la plus grande CAE qui a son siège en Île-de-France : « Non pas que la création d’entreprises soit absurde ou dangereuse en tant que telle, mais parce que sa promotion effrénée mène aujourd’hui une majorité de porteurs de projets à une précarité sociale certaine. Qu’est-ce qu’un auto-entrepreneur sinon un professionnel à qui on offre le droit de s’auto-exploiter en sacrifiant volontairement sa propre protection sociale et ses droits ? […] L’enjeu des années à venir n’est pas tant de transformer chaque salarié en “entrepreneur de soi” que de repenser le travail lui-même et les rôles de l’entreprise. » [Veyer, 2010]
Les CAE ont donc été conçues pour répondre à la fois à la crise de l’emploi et au désir d’une émancipation du travail : elles ont l’ambition d’apporter, comme l’explicitent deux autres membres de Coopaname, « des éléments de réponse de l’économie sociale au délitement du rapport salarial fordien. […] Les CAE réinterrogent à la fois le modèle salarial et le modèle entrepreunarial. […] Réhabiliter le travail dans la dimension émancipatrice est au cœur du projet politique de Coopaname. » [Bodet, Grenier, 2011] Pour cela, les initiateurs du mouvement des CAE ont puisé largement aux sources du socialisme utopique.
3.2 – Des canuts aux CAE
Les CAE trouvent leurs racines dans l’histoire sociale de Lyon, cette histoire qui avait vu, au xviiie siècle, les premières révoltes ouvrières, notamment celle des canuts de la Croix Rousse [4]. Et c’est encore les artisans de la soie qui, dans les années 1960, ont été les acteurs d’un important mouvement coopératif. Il est à noter que, déjà à cette époque, leur lien avec l’entreprise commerciale et les modalités de travail ressemblaient par bien des aspects aux formes de la sous-traitance qui se sont généralisées aujourd’hui : « Ces artisans travaillent “à façon” pour des donneurs d’ordre, établis à leur compte avec leur matériel. Ils doivent supporter beaucoup de charges et l’activité du tissage de la soie est menacée. Sur les conseils de l’administration fiscale et sociale, un groupe de Croix-Roussiens décide de créer une coopérative ouvrière de production, COOPTIS. Ainsi, ils bénéficient du statut de salarié avec une meilleure protection sociale pour traverser les périodes de crise fréquentes dans le textile. Chaque tisseur garde son autonomie et sa liberté, tout en mutualisant un statut juridique. » [Poncin, 2004, p. 64-66] La coopérative s’est développée progressivement jusqu’à compter 200 salariés « indépendants » en 1981. Pendant plus de vingt ans, elle a donc permis à des tisseurs de continuer leur travail : chacun tirait son revenu du travail qu’il effectuait à domicile sur son métier à tisser, tandis que l’entreprise se chargeait d’établir les factures, les fiches de paie et d’assurer la comptabilité, moyennant une contribution de 3 % du chiffre d’affaires de chaque tisseur. Les tisseurs gardaient donc la maîtrise totale de leur travail et de leurs relations avec les donneurs d’ordre. Par ailleurs, une négociation menée avec les ASSEDIC leur permettait d’être salariés lorsqu’ils avaient des commandes et d’être licenciés lorsqu’ils n’en avaient pas (en bénéficiant des allocations chômage durant ces périodes).
Une autre expérience a inspiré la naissance des CAE, celle de la SMTS à Grenoble dont il a été déjà question ci-dessus, une entreprise d’insertion créée dans les années 1980 par des travailleurs sociaux et devenue SCOP en 1995 : « L’originalité de cette entreprise est de combiner une vision d’entreprise globale (entrepreneuriat collectif) avec des secteurs d’activité autonomes (entrepreneuriat individuel), et de rechercher la pérennité des emplois, tout en assurant une fonction d’insertion économique pour des personnes en difficulté. » [Poncin, 2004, p. 68] Le fonctionnement global de SMTS repose sur une mutualisation assez poussée. Ainsi, les chiffres d’affaires de toutes les personnes disposant d’un compte sont comptabilisés analytiquement en fin d’année, ce qui conduit à procéder au constat d’activités en perte et d’activités en excédent. Les coopérateurs acceptent que des comptes soient temporairement déficitaires : une personne peut faire le choix, par exemple, de prendre quelques mois de congés « sabbatiques » tout en étant payée, au risque d’être en déficit cette année-là. Dans ce système, chacun peut donc être, tour à tour, « redevable » à l’égard des autres ou créancier des autres. Cette forme de mutualisation implique donc la construction d’une confiance réciproque et suppose un engagement des personnes dans la durée. Ces deux expériences, COOPTIS et SMTS, sont fondatrices du concept de Coopérative d’activité et d’emploi.
Dans les années 1980, la figure du « porteur de projet » émerge négativement, comme réponse à la crise de l’emploi, et positivement comme possibilité de développement d’un travail autonome. En 1985, Élisabeth Bost avait créé une association dont le but était d’offrir un cadre aux « porteurs de projet ». À cette même époque, elle avait été recrutée dans une pépinière d’entreprises, une structure d’accueil et d’accompagnement des « chômeurs-créateurs ». C’est dans ce contexte qu’elle avait commencé à réfléchir autour d’un projet permettant d’agencer les deux missions, une réflexion qui devait déboucher sur la création en 1995, à Lyon, de la première CAE, CAP Services. Au moment où les phénomènes de précarité s’accentuaient et les micro-entreprises individuelles proliféraient, il s’agissait de concevoir « un outil pour des personnes en capacité de développer un savoir-faire par l’entrepreneuriat, tout en facilitant l’insertion sociale des exclus du travail » [Poncin, 2004, p. 73].
Depuis, les Coopératives d’activité et d’emploi se sont diffusées sur le territoire national par essaimage, en prenant des formes variables, en fonction des spécificités locales, du contexte de leur création et de l’histoire de leurs initiateurs, et elles se sont reliées entre elles à travers deux réseaux, le réseau Coopérer pour entreprendre et le réseau Copéa (association nationale des Coopératives d’activité), dont les sensibilités différentes illustrent bien la dualité consubstantielle au projet. Le réseau Copéa privilégie le développement d’un entreprenariat viable à long terme, tandis que la part du financement public est plus importante dans les CAE du réseau Coopérer pour entreprendre, reflétant ainsi l’accent mis sur la mission de service public, c’est-à-dire l’accompagnement offert à tout porteur de projet qui frappe à leur porte [5].
Les CAE se sont donc développées au confluent de deux perspectives distinctes. Comme le souligne Béatrice Poncin, « le concept est double et son appellation porte cette gémellité : il s’inscrit à la fois dans un objectif d’insertion par l’économique – le nom de la coopérative d’activité est utilisé dans le sens de pouvoir tester une activité – et dans un objectif de développement collectif et solidaire d’activités – le nom de coopérative d’emploi signifie la mise en commun durable d’emplois » [Poncin, 2004, p. 73]. Notons que Béatrice Poncin préfère parler de Coopératives d’emploi et d’activité, comme pour souligner que dans sa perspective, la forme d’emploi que portent ces coopératives est première par rapport à la mission d’insertion par l’économique. Cette différence met en exergue la coexistence de deux projets politiques très différents.
L’histoire d’Oxalis, membre de Copéa, illustre la prééminence du projet du développement de l’entrepreneuriat sur l’objectif d’insertion. À l’origine, en 1986, un groupe d’une vingtaine de personnes qui se sont rencontrées dans des mouvements d’éducation populaire réfléchissent ensemble au sens du travail et de l’engagement. Oxalis naît ainsi d’un projet collectif articulé sur l’idée de « vivre et travailler autrement » qui a donné naissance à deux associations (l’une en 1988, l’autre en 1992), puis à une SCOP en 1997. Depuis ses débuts, Oxalis poursuit un but ambitieux : « Créer et développer des activités économiques et contribuer ainsi au développement d’un monde rural vivant et solidaire tout en faisant le lien avec le monde urbain ; “vivre et travailler autrement”, c’est-à-dire faire en sorte que la personne ne soit pas l’objet d’une juxtaposition plus ou moins réussie de toutes les composantes de sa vie (sociale, familiale, personnelle et professionnelle), mais qu’il y ait un projet central à toutes ces dimensions. » [Poncin, 2004, p. 97-99] L’organisation a été conçue dans ce but : polyvalence entre activités intellectuelles et activités manuelles, répartition transversale des tâches pour éviter toute hiérarchie, égalité des salaires (quels que soient l’ancienneté, les diplômes ou les tâches effectuées), prise de décision par recherche de consensus. En 2001, la SCOP a muté dans son fonctionnement, prenant la configuration d’une coopérative d’emploi et d’activité.
Plus généralement, depuis la création des premières CAE dans les années 1990, les objectifs poursuivis par ces entreprises se sont complexifiés et enrichis, faisant converger, non sans tensions, les deux projets qui les animent [Veyer, 2011]. Pour les directeurs actuels de Coopaname, membre du réseau Coopérer pour entreprendre, la première génération de CAE s’efforçait avant tout de sécuriser le parcours des porteurs de projets. Puis les CAE ont évolué vers un projet plus ambitieux et global, devenir une entreprise partagée : « Les CAE de deuxième génération ne visent plus à sécuriser la création d’entreprises individuelles, mais bien à construire une alternative à celles-ci, via un projet d’entrepreneuriat collectif. » [Sangiorgio, Veyer, 2009]. Enfin, la troisième génération des CAE vise la constitution de la coopérative en tant que mutuelle de travail, notion dont le contenu reste largement à définir.
3.3 – De la sécurisation à la mutuelle de travail
L’entrepreneur-salarié n’a pas de statut juridique propre : en tant que porteur de projet, il est conduit à assumer des fonctions entrepreneuriales, mais en tant que membre d’une CAE, il est salarié de la structure coopérative et il peut même envisager d’en devenir sociétaire. Dans certaines coopératives, cet engagement devient obligatoire au bout de trois ans, à partir de l’entrée dans la CAE. Tout porteur de projet peut solliciter son adhésion à une CAE. Son statut évolue alors, depuis la phase initiale, celle de l’accueil et de la validation du projet par la CAE jusqu’à la concrétisation du projet. Dans la phase initiale, celle du bilan de la situation sociale et professionnelle, le porteur de projets peut se retrouver dans différentes situations (allocataire des indemnités de chômage, du RSA, sans revenu…). Dans la phase de développement du projet, lorsque son activité commence à produire un chiffre d’affaires, il devient entrepreneur-salarié, c’est-à-dire qu’il est salarié en CDI de la CAE ; son salaire est déterminé en fonction du chiffre d’affaires réalisé et évolue avec celui-ci. Par la suite, il est susceptible de devenir entrepreneur-associé, ou bien il peut choisir de quitter la coopérative pour créer son entreprise individuelle. Tout au long de ce parcours, le porteur de projets est accompagné par la structure. L’accompagnement individuel et collectif constitue l’une des activités propres aux CAE, soutenues par les pouvoirs publics, pour s’efforcer de rendre viables le plus grand nombre de projets.
L’absence de subordination constitue une valeur centrale pour certaines CAE comme Coopaname. Le rejet de la subordination, telle qu’elle a été vécue au cours d’expériences antérieures de travail salarié, constitue d’ailleurs, d’après les entretiens que nous avons réalisés, l’une des motivations premières de l’adhésion à Coopaname. Dans le modèle de la CAE, s’il n’y a pas de patron (remarquons justement le titre du livre de Béatrice Poncin : Salariés sans patron ?), le fait que le porteur de projet demande son adhésion à une CAE revient à faire acte d’une « subordination volontaire », mais dans le sens d’une dépendance vis-à-vis du collectif. En même temps, son autonomie est limitée par le pouvoir du donneur d’ordres. Le fait d’appartenir à un collectif modifie le rapport avec le donneur d’ordres. L’un des enjeux fondamentaux pour la coopérative est donc d’améliorer, grâce à la mutualisation, le rapport de force face aux donneurs d’ordres. Si la mutualisation est au fondement des CAE, son approfondissement, selon des scénarios qui restent à imaginer, constitue un enjeu majeur pour accroître l’autonomie et l’indépendance des porteurs de projets vis-à-vis des donneurs d’ordres.
La notion même de mutuelle laisse place aux divergences d’interprétation. Pour l’Encyclopédie universelle, « mutuel » signifie « qui comporte ou manifeste un rapport d’échange ou de réciprocité entre deux ou plusieurs personnes ». Ce qui englobe donc toute forme de réseau basé sur un principe de réciprocité, de don/contre-don, même étendu et différé. Selon le code de la mutualité, « les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie » (article 111-1). Leur vocation est donc d’élaborer pour et avec leurs adhérents des réponses aux besoins sociaux qu’ils expriment. À la différence de la coopérative, dont l’objet social reste la réalisation d’une activité commune, la mutuelle vise d’abord la protection et le développement de ses membres. Mais de nouvelles acceptions du terme émergent des processus d’innovation au sein de l’économie sociale. Ainsi, le concept récent de « mutuelle de public » (exemple MASC – Mutuelle arts, sciences, social, culture) désigne une communauté intéressée au développement d’un projet particulier [6].
Depuis quelques années, Coopaname a engagé une recherche-action pour imaginer son devenir, avec le projet d’aller au-delà des principes de la coopérative d’activités et d’emploi sur la base de laquelle elle s’est constituée. L’ambition affirmée par le document fondateur de ce projet est de réinvestir les principes mutualistes pour innover en matière de travail et d’emploi. Constatant que Coopaname apparaît à bien des égards comme une CAE hors normes par sa taille, sa gouvernance, ses modes de fonctionnement ou sa dynamique, les auteurs voient dans l’accroissement rapide des capacités d’action de la coopérative en même temps que dans le poids des contraintes qui s’imposent à elle, la source d’un désir de repenser le projet de la coopérative lui-même. À l’heure actuelle, la coopérative compte une majorité de femmes (plus de 60 %) et se caractérise par un niveau de formation élevé (plus de 60 % ont au moins Bac+3). Les métiers qualifiés de services apparaissent sur-représentés dans la palette de ses activités. Si les entrepreneurs-salariés qui parviennent à dégager un revenu suffisant tendent à rester dans la coopérative, ce qui est un signe de leur engagement, ils ne constituent encore qu’une petite minorité. C’est ce qu’a révélé une enquête réalisée par la CAE en 2011 pour l’université d’automne : « Ah ! si j’étais riche… Gagner plus pour partager plus. Et vice-versa. » La réflexion sur le devenir de Coopaname se développe à partir de ce constat préoccupant. Elle a déjà donné lieu à une première recherche en 2008, notamment soutenue par la DIIESES (Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale), sur l’objet social de Coopaname, au cours de laquelle a émergé l’idée que le métier de la coopérative pourrait relever davantage d’une logique mutualiste que coopérative. « Que pourrait être une Mutuelle de travail ? », s’interrogent alors les auteurs : « Tout simplement une société de personnes dans laquelle on se protégerait mutuellement nos parcours professionnels – autrement dit, notre capacité à pouvoir vivre décemment d’activités professionnelles que l’on choisit. […] Pourrait-on organiser dans le cadre de Coopaname, entre plusieurs centaines de membres, des mécanismes systématiques d’accompagnement mutuel, d’apprentissage mutuel, de salariat mutuel, de formation mutuelle, de protection mutuelle, de secours mutuel (etc.) qui permettraient de sécuriser chacun – grâce aux autres – dans sa capacité à gagner sa vie avec ce qu’il souhaite faire, en coopération avec qui il choisit de travailler, et au rythme qu’il se fixe ? »
Si le document met l’accent sur la notion de protection, il envisage d’emblée plusieurs interprétations possibles de la notion de « mutuelle de travail », prenant acte du fait que l’on peut poursuivre différents buts, en fonction de la vision que l’on a du travail lui-même et de la place qu’on souhaite lui accorder. Pour les auteurs, la mutuelle peut ainsi être imaginée de différentes façons : comme un support d’émancipation dans le travail, pour résister aux différentes formes de subordination et d’hétéronomie ; comme un vecteur pour faciliter les transitions professionnelles, voire organiser « à force de relectures de Fourier, une papillonne effective », transformant ainsi l’obligation de produire en une activité ludique ; comme un moyen de permettre à chacun de « vivre le mieux possible en travaillant le moins possible ».
4 – La fabrique institutionnelle au sein de Coopaname
L’un des signes majeurs de la mutation en cours au sein de Coopaname est l’émergence de collectifs à l’intérieur de la SCOP et la formalisation des rapports entre la coopérative et ses entités économiques internes. Ainsi, même si cette dynamique ne concerne pas tous les entrepreneurs-salariés [7], Coopaname se présente aujourd’hui comme une sorte de laboratoire au sein duquel s’expérimente la formation de collectifs à géométrie variable, offrant une palette étendue de possibilités d’articulation entre activité individuelle et engagement collectif. La conception du collectif qui se dessine à travers cette dynamique n’est pas celle d’un groupe aux frontières définies, auquel chacun appartiendrait ou non, mais plutôt celle d’un processus orienté vers la possibilité d’un devenir commun [8]. Cette vision renoue en quelque sorte avec l’utopie fouriériste des « séries passionnées [9] », en offrant à chacun la possibilité de choisir ses coopérations ainsi que la durée de celles-ci, de circuler entre différents niveaux d’engagement, entre plusieurs formes d’« indépendance à plusieurs » [Bureau, Corsani, 2012]. L’engagement ainsi conçu ne s’inscrit pas dans un devoir moral mais plutôt dans la passion et la recherche du plaisir, comme en témoignent les propos des coopanamiens. Mais si la passion est le moteur des engagements individuels, le défi posé aux dirigeants de la structure reste la production de règles qui permettent de favoriser et de consolider ces « engrenages » mutuels sans altérer la dynamique d’ensemble [Devolvé, Veyer, 2009].
Nous avons repéré quatre différentes formes d’intégration collective, instituées à des degrés divers, qui coexistent actuellement au sein de la CAE : les groupes métiers, les espaces de co-working, la coopération par projet, les groupes de marque. Enfin, la forme particulière que prennent les instances de représentation du personnel contribue à l’institution d’une entreprise partagée.
4.1 – Les groupes métiers : formation mutuelle et construction de réseaux professionnels
Formés très tôt dans l’histoire de la coopérative et particulièrement actifs, ces groupes métiers (métiers de l’écrit, relations humaines, photographes, métiers de la communication, etc.) qui se réunissent au moins une fois par mois remplissent, de l’avis des coopanamiens que nous avons rencontrés, une double fonction :
-
- un rôle de formation technique par mutualisation des savoirs, voire de régulation professionnelle par un effort, plus ou moins couronné de succès, pour s’accorder sur des tarifs communs ;
- un rôle d’interconnaissance, ouvrant la possibilité d’une construction de la confiance et favorisant ainsi l’émergence de coopérations plus ou moins durables, à partir d’engagements graduels.
En raison du rôle majeur de la confiance dans le développement et la stabilisation des échanges, comme dans la cohésion même de la société [Simmel, 1987], les conditions de production de la confiance ont fait l’objet de nombreuses investigations de la part des économistes et des sociologues [Thuderoz et al., 1999]. Zucker [1986] propose une typologie plus analytique en distinguant la confiance intuitu personae(celle que l’on accorde à sa famille ou à des personnes en raison de leurs caractéristiques propres), la confiance institutionnelle, attachée à une structure formelle, et la confiance relationnelle. La confiance relationnelle, celle qui est manifestement en cause dans la vie interne à Coopaname, se fonde sur les échanges passés entre les partenaires, c’est-à-dire sur une expérience de la relation. Elle se construit dans les processus de don/contre-don, se nourrit de signaux comme une attitude coopérative et l’absence de tricherie, tire profit du partage d’une culture commune ; elle est favorisée par la stabilité de l’organisation au sein de laquelle les parties sont engagées et s’appuie sur la création de routines partagées. Sur la base de cette confiance, d’autres collectifs peuvent alors se constituer (cf. 3.3). A contrario, l’absence de confiance, soit qu’elle n’ait pas pu s’établir faute d’occasions de rencontres, soit que les signaux échangés dissuadent la coopération, représente l’un des principaux obstacles à la dynamique collective. Si les groupes métiers favorisent la construction de la confiance, celle-ci ne peut se décréter, d’autant que les membres de ces groupes sont, au moins partiellement, en concurrence les uns avec les autres sur les mêmes marchés.
4.2 – Des lieux et des équipements partagés : favoriser les rencontres et les innovations collaboratives
À l’image des espaces de co-working, des hackerspaces ou des fablabs [10], Coopaname offre aussi un espace physique commun pour des professionnels de spécialités très diverses, favorisant ainsi des rencontres et des associations imprévues et, par conséquent, l’innovation et l’émergence de projets collectifs. Dans ce cadre, c’est l’exploitation créative du hasard (ou sérendipité) qui est suscitée, plus que la confiance. La confiance devient d’ailleurs moins vitale dans un contexte où la diversité des compétences atténue la concurrence. Loin des routines communes à un collectif de métier, c’est au contraire la complémentarité, le décalage de perspectives, qui provoquent l’innovation. Après l’accès à la protection sociale, les chances de rencontres fructueuses offertes par la multi-activité de la coopérative, constituent ainsi une motivation forte exprimée par les entrepreneurs-salariés pour expliquer leur engagement dans Coopaname.
Tout récemment, la coopérative s’est engagée dans l’organisation d’espaces partagés de travail et pourrait s’orienter vers une mise à disposition d’équipements et d’outils techniques variés, se rapprochant ainsi davantage de la philosophie propre au mouvement maker. Elle est d’ailleurs partie prenante d’un projet dionysien de recherche-action, prévoyant la création de trois espaces au sein d’un même bâtiment : une boutique proposant à la vente des produits d’artisanat locaux, un espace de coworking dénommé « bar à travail » et un fablab.
4.3 – Partage des commandes et coopération sur projet
Si l’innovation, pas plus que la confiance, ne peut se décréter, il existe donc en revanche des conditions favorables à leur émergence. L’interconnaissance amorcée dans les groupes métiers ou dans les espaces communs débouche ensuite parfois sur des relations professionnelles plus durables : sous-traitance, association sur un projet, réponse commune à des appels d’offres, etc. Dans une logique de métier, tel ou tel coopanamien peut, de fil en aiguille, s’entourer de personnes compétentes pour déléguer des travaux et répondre ainsi à des commandes qu’il ne peut honorer seul. La redistribution d’un surplus de travail se fait alors de manière ponctuelle, à la faveur de la confiance dans le travail de l’autre, telle qu’elle s’est construite progressivement. Cette pratique apparaît assez répandue à Coopaname, par exemple dans le domaine du télé-secrétariat. Une autre forme intermédiaire de construction de collectif est la réponse commune à un appel d’offres, en mobilisant une pluralité de spécialités complémentaires. Par exemple, lors d’un appel d’offres lancé par un OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) la palette de compétences présente à Coopaname a permis de construire, en deux semaines, une réponse qui couvre la presque totalité des thématiques figurant dans l’appel d’offres. Le travail d’élaboration collective a fédéré 24 entrepreneurs-salariés (dont une moitié comme suppléants), ce qui leur ouvre la possibilité d’évoluer ultérieurement vers une entité économique plus pérenne, en l’occurrence un organisme de formation. Ces formes de redistribution et de mutualisation du travail, basées à la fois sur des rapports de confiance établis au fil du temps et sur des complémentarités productives, s’apparentent à ce qui se passe dans les bureaux de pigistes. L’expérience du Terrier d’Hégésippe, rapporté par Pierre Tessier [2012], en témoigne : les « rongeurs » (comme s’appellent eux-mêmes les membres du Terrier) mettent en commun tout ou partie de leurs carnets d’adresses afin de multiplier les pistes de collaboration ; ils mutualisent aussi certaines piges et s’efforcent de mettre à profit leurs complémentarités de savoir-faire, même s’ils peinent à élaborer des offres intégrées.
4.4 – La construction d’entités économiques : les « groupes de marque »
À partir des groupes métiers et des coopérations ponctuelles ont émergé différentes tentatives de se regrouper durablement pour faire évoluer le rapport de forces avec les commanditaires ou les donneurs d’ordres et/ou de construire une offre commune à partir de prestations complémentaires. Par exemple, la marque « Kit à se marier » offrait un ensemble de prestations autour de l’organisation d’un mariage (robes de mariée, graphisme, bijoux, photographes, etc.). Les premiers groupes de marque issus de la CAE ne sont pas parvenus à s’imposer sur un plan commercial, mais plusieurs projets en cours tentent de tirer profit des expériences passées. Les collectifs émergents ont en particulier développé une réflexion sur la façon d’organiser à la fois la production et le fonctionnement démocratique de l’entité, construisant de façon fractale une mini-scop à l’intérieur de la coopérative. Novéquilibres est à cet égard souvent cité en exemple par les coopanamiens, en particulier pour le travail politique d’organisation de la structure. L’un des initiateurs de la mini-scop, ancien directeur des ressources humaines dans une société d’informatique, a fait d’emblée le choix de s’engager dans cette activité collective, sans développer par ailleurs d’activité individuelle en propre, ce qui était en rupture avec les usages de l’époque au sein de la CAE. Les participants à la réflexion se sont attachés à distinguer animation et pilotage de projet. Novéquilibres dispose ainsi d’un comité exécutif élu (le noyau dur), en charge du pilotage de projet, mais les neuf associés (ou membres actifs) se retrouvent pour des réunions mensuelles au cours desquelles les décisions se prennent sans qu’il y ait de vote. Spécialisé dans l’offre de services auprès des organisations pour favoriser la qualité de vie au travail, le collectif regroupe plusieurs professionnels ayant acquis une expérience dans le domaine des ressources humaines. Il n’hésite pas à recourir par ailleurs à des techniques et à des pratiques spécifiques de prise de décision, empruntées par exemple au courant de la sociocratie, de façon à construire collectivement la décision finale [11].
Au cours des entretiens, plusieurs coopanamiens ont évoqué une sorte de tabou de la prospection commerciale qui conduirait à l’échec économique des groupes de marque, en dépit d’une réflexion très poussée sur la structuration des collectifs. Ce qui soulève, à leurs yeux, la question d’organiser, au niveau de Coopaname, un support mutualisé pour faciliter la recherche de clientèle. Explicitement rejetée aux débuts de la coopérative, la mutualisation de la prospection et du lien avec les usagers, pourrait aujourd’hui prendre sens au sein du collectif, dans le cadre d’une réflexion plus globale sur l’intégration dans le projet politique de la CAE de la relation entre producteurs et consommateurs.
L’idée d’articuler activité individuelle et engagement dans une activité commune nourrit aussi les rêves de nouveaux entrants. L’un d’entre eux imagine ainsi que chaque coopanamien pourrait consacrer une part de son temps à une œuvre collective, à côté de son activité propre, ce qui permettrait d’alimenter une caisse commune. Plus récente dans la culture de la coopérative, cette réflexion oblige les coopanamiens à repenser en profondeur la notion d’accompagnement collectif. Plus qu’une injonction à s’intégrer dans un groupe, il s’agirait de créer des synergies collectives profitables à tous, ce qui rejoint largement les réflexions et les interrogations sur les pratiques d’empowerment [Bacque, Biewiener, 2013].
La création institutionnelle bute face à la structure du droit français, édifiée sur la distinction binaire entre travail salarié et travail indépendant et la CAE se trouve régulièrement en porte-à-faux avec les institutions d’une société salariale. Ses membres ont donc fait le choix d’élaborer leurs propres textes, sur la base de leurs pratiques, avant d’entrer en discussion avec des juristes et en négociation avec les pouvoirs publics. Un contrat interne a ainsi été élaboré pour régir les rapports entre la coopérative et les entités économiques qui se développent en son sein. Ce contrat définit de fait une autonomie encadrée : l’entité constitue, au niveau comptable, un centre de production et socialement, une unité de travail, mais elle ne détient pas de personnalité morale, elle s’engage à respecter les principes coopératifs et reste soumise aux décisions du Conseil d’Administration de la CAE. Le contrat prévoit aussi des engagements réciproques entre la CAE et l’entité économique, sur la base du principe suivant : l’un des objets de la coopérative étant de faire économie ensemble, l’idée est ici de favoriser les coopérations internes, sans qu’elles aient aucun caractère d’obligation.
4.5 – La représentation collective des entrepreneurs-salariés
Au vu du nombre de ses salariés, Coopaname est soumise depuis 2005 à l’obligation légale d’une représentation du personnel. Les membres de la CAE ont donc engagé une réflexion pour définir le rôle des représentants, dans ce contexte très particulier où chacun est à la fois son propre employeur et son propre salarié. N. Devolvé et S. Veyer [2010, p. 5] retracent ainsi cette histoire : « À l’élection d’IRP fantoches permettant de mettre la coopérative en conformité avec la lettre de la loi, il fut préféré une méthode consistant à se placer dans l’esprit de la loi afin d’imaginer une représentation du personnel adaptée réellement aux enjeux de la coopérative, quitte à prendre son temps, et quitte à prendre quelques libertés avec la lettre de la loi. » Redéfinissant le contrat de travail qui lie chaque entrepreneur-salarié à la coopérative comme une subordination volontaire au collectif, ils voient dans la représentation du personnel une protection contre les différentes formes de dépendance, un moyen d’aider les entrepreneurs-salariés à se protéger d’eux-mêmes, de la précarité intrinsèque au travail autonome, mais aussi de leurs donneurs d’ordres. Ils mettent en exergue « tout le sens que peut revêtir de remettre du droit, du dialogue social, de la protection sociale, là où il n’y en a habituellement plus, dans le travail indépendant. Loin d’être une absurdité, les IRP constituent l’un des rouages essentiels des CAE et du projet qu’elles portent » [Devolvé, Veyer, 2010, p. 7]. La représentation des entrepreneurs-salariés vise ainsi à protéger collectivement les salariés des employeurs de soi-même qu’ils sont par ailleurs. Elle se veut aussi la cheville ouvrière d’une « pédagogie de la résistance » contre les pratiques abusives, voire irrégulières, des donneurs d’ordre et des clients qui tendent à imposer un moins-disant social. Elle constitue enfin un contre-pouvoir pour limiter le pouvoir moral que la direction de la SCOP exerce de fait à l’égard de ses membres. Ainsi conçue, la représentation des entrepreneurs-salariés peut être vue comme une innovation institutionnelle, au sens où elle adapte un dispositif central des relations professionnelles dans un contexte où les risques psychosociaux ne découlent pas du lien de subordination lui-même mais d’autres formes de dépendance économique et morale ainsi que du surinvestissement des entrepreneurs-salariés dans leur propre activité.
5 – Conclusions
Si la naissance des CAE est liée à la crise de l’emploi et aux injonctions croissantes à devenir créateur de son emploi, elles subvertissent, en quelque sorte, à la fois la logique de l’emploi et donc du salariat, et celle de l’auto-entrepreneuriat. En promouvant un entrepreneuriat collectif et coopératif, elles opposent une résistance aux politiques visant le développement de l’entrepreneuriat individuel, en même temps qu’elles expérimentent des formes novatrices des relations de travail. En articulant des espaces d’échanges professionnels avec des espaces propices à l’innovation, en élaborant des modèles politiques d’organisation interne, en détournant de façon créative des institutions de la société salariale, Coopaname participe du vaste chantier d’auto-institution de la société.
Cependant, la faiblesse des revenus que perçoivent la plupart des entrepreneurs-salariés est un problème majeur pour chacun et fragilise la vie de la coopérative. Les formes originales d’articulation entre activité individuelle et engagement collectif que nous avons observées et analysées constituent une réponse, bien que partielle, au problème et un premier pas dans le devenir de mutuelle de travail. Coopaname s’est engagée à cet égard dans un vaste chantier de production du droit, à la lisière entre droit du travail et droit des entreprises, mais se heurte, dans ce projet, à de nombreuses limites. Nous n’en citerons que trois.
Une première limite tient au fait que le salaire reste déterminé de manière individuelle, sur la base des honoraires ou du chiffre d’affaires réalisé par chaque entrepreneur-salarié, alors même que la richesse créée par la coopérative, fruit des synergies engendrées par la dynamique des collectifs, excède la somme des chiffres d’affaires réalisés par l’ensemble des membres de la CAE. En d’autres termes, la richesse de la CAE déborde la valeur marchande des activités qu’elle abrite, mais c’est sur la base de cette dernière qu’est calculé le salaire. Ce résultat nous a conduites à envisager, dans une nouvelle phase de notre enquête de terrain, une analyse fine des temps permettant de mesurer le temps consacré à l’engagement dans le collectif et d’imaginer, avec les participants à l’enquête, les modalités de valorisation de ces temps de travail gratuit et de partage des fruits de cette valorisation.
La deuxième limite est donnée par le fait que beaucoup d’entrepreneurs-salariés rencontrent de grandes difficultés de commercialisation. Ne faut-il pas envisager la mutualisation des fonctions commerciales ? Ou même pousser plus loin la réflexion sur l’évolution des rapports entre producteurs et consommateurs ? Il s’agit là d’une piste que nous avons proposée à la coopérative et qui sera poursuivie sur la base des éléments de l’enquête projetée.
Une troisième limite concerne les droits sociaux acquis par les entrepreneurs-salariés, définis à partir de la norme de l’emploi en CDI. En effet, si la CAE permet de transformer en salaire le chiffre d’affaires ou les honoraires des membres et les faire ainsi bénéficier des droits sociaux – contrepartie de la subordination salariale dans le cadre du rapport de travail capitaliste –, les critères d’ouverture des droits et la nature des droits restent inadaptés à la situation de l’entrepreneur-salarié. La production instituante du droit au sein des CAE se heurte donc de façon récurrente aux fondamentaux du droit social, toujours fondé sur la logique binaire entre travail salarié et travail indépendant. Les CAE pourraient être un acteur majeur dans une bataille pour une nouvelle conception de la protection sociale. En partant des pratiques de travail et d’emploi, elles pourraient inventer des modèles adaptés à des formes de l’activité de travail, irrégulières en termes de temps et de rémunérations. Dans cette perspective, l’enquête que nous menons actuellement sur les temps et les revenus devrait aussi permettre d’avancer dans cette direction.
Notes
-
- [1] En France, l’économie sociale et solidaire (ESS) est une construction politique récente, consacrée en 2000 par la création d’un secrétariat d’État à l’ESS à la suite du rapport Lipietz, née du rapprochement entre le secteur historique de l’économie sociale (mouvement associatif, coopératif et mutualiste) et un certain nombre d’initiatives plus récentes se réclamant de l’économie solidaire, défendant la pluralité des principes de régulation économique (réciprocité, marché, redistribution).
- [2] Coopaname a été créée en 2004. D’après le rapport d’activité 2013, elle rassemble 672 personnes dont 147 associés.
- [3] Dernière en date, la bataille pour la reconnaissance institutionnelle des CAE a été gagnée avec le vote du 20 mai 2014 à l’Assemblée nationale.
- [4] Les émeutes de 1744 à Lyon marquèrent la naissance du mouvement ouvrier en France. Les artisans de la soie luttaient contre le pouvoir de l’industrie naissante. En 1790, les premières expériences d’autogestion virent le jour. Et ce fut par l’action des canuts qu’eut lieu, en 1806, le premier Conseil des prud’hommes. Puis, les révoltes des canuts de 1831, de 1834 et de 1848 s’accompagnèrent du développement des premières formes de mutualité (sociétés mutualistes, épiceries coopératives, caisses de secours mutuel). Il fut aussi créé le premier journal ouvrier : L’Écho de la fabrique, qui, en 1833, sortit avec le titre « Prolétaires de tout État, unissez-vous » [Perdu, 2010].
- [5] En 2013, le résau COPEA compte quelque 1 000 entrepreneurs (dont plus d’un tiers associés) qui réalisent 27 millions de chiffre d’affaires. Le réseau Coopérer pour entreprendre compte, quant à lui, quelque 4 000 entrepreneurs salariés qui réalisent au total un chiffre d’affaires 37 millions d’euros.
- [6] Il est à noter que ce type de formule se développe aujourd’hui beaucoup sur Internet avec les pratiques de crowdfunding.
- [7] Les motivations qui justifient l’entrée dans la CAE sont hétérogènes, certains entrepreneurs-salariés ne recherchent rien d’autre dans la CAE que l’accès aux droits sociaux, alors que pour d’autres il s’agit d’expérimenter collectivement un autre rapport au (et de) travail.
- [8] On retrouve ici la définition, par Gilbert Simondon [1989], du collectif comme processus par lequel des individus mettent en commun leurs « réserves de devenir ».
- [9] Pour Charles Fourier [1829], les séries passionnées « doivent être réglées par l’attraction ; chaque groupe ne doit se composer que de sectaires engagés passionnément, sans recourir aux véhicules de besoin, morale, raison, devoir et contrainte ».
- [10] Ces espaces sont des lieux équipés d’ordinateurs et/ou de machines numériques, qui offrent la possibilité à des ingénieurs,designers, artistes, bricoleurs, travailleurs indépendants, etc., de se retrouver et de réaliser des projets individuels ou collectifs, en dehors de tout lien hiérarchique. Ils sont généralement partie prenante du mouvement maker.
- [11] Pour Gérard Endenburg [1998], le terme « sociocratie » se réfère à un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une organisation de se comporter comme un organisme vivant, de s’auto-organiser. En fait, le terme de sociocratie a été utilisé tout d’abord par Auguste Comte pour désigner la gouvernance du socios, c’est-à-dire des personnes liées entre elles par des relations significatives. À l’aube du xxe siècle, le socialiste jaurésien Eugène Fournière [1910] y voit une issue positive à l’alternative entre démocratie pure et socialisme autoritaire, une forme de gouvernement de la société par elle-même, prenant appui non sur une masse indifférenciée d’individus mais sur des organisations associatives.
Source: